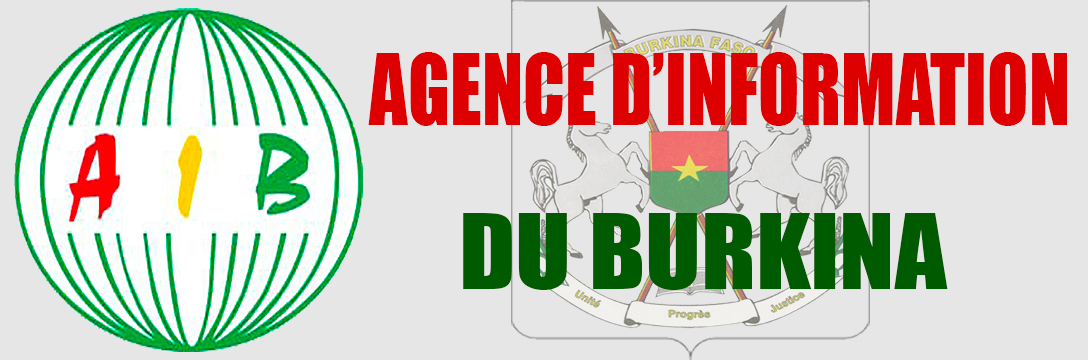Roger Baro, ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement
« Nous mettons un point d’honneur pour que l’eau ne soit pas un handicap à l’Offensive agropastorale et halieutique »
Titulaire d’une Maitrise en Géographie physique de l’université de Ouagadougou et inspecteur de l’environnement, après avoir validé un mémoire d’ingénieur à l’université de Bobo-Dioulasso sur la vulgarisation agricole en 2015, Roger Baro est l’actuel ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement. Reçu comme l’invité de la rédaction de Sidwaya, mercredi 18 septembre 2024 à Ouagadougou, il a fait un tour d’horizon des questions de l’heure en lien avec le changement climatique, l’impact de l’exploitation artisanale de l’or sur l’environnement, le reboisement, la dégradation du couvert végétal et la dissolution de l’unité spéciale d’intervention des eaux et forêts.
Sidwaya (S.) : Quel a été votre parcours professionnel avant votre nomination comme ministre en charge de l’environnement ?
Roger Baro (R.B.) : Avant tout, permettez-nous de traduire notre gratitude au président du Faso, chef de l’Etat et au Premier ministre pour l’honneur qu’ils nous ont fait en nous confiant les navires Environnement, Eau et Assainissement. Avec mon équipe, nous travaillons d’arrache-pied pour exécuter à la lettre la politique du gouvernement en la matière.
Pour en venir à votre question, dans notre cheminement dans l’Administration publique, nous avons eu la chance de 2016 à 2023 d’occuper des postes de responsabilité. D’abord comme directeur de la promotion de l’éducation environnementale de 2016 à 2018, directeur de la prévention et la pollution des risques environnementaux de 2018 à 2022 et directeur général de la préservation de l’environnement de 2022 à 2023. Ce, avec des positions administratives telles que membre du conseil d’administration de l’ANEMAS. Etant à ces positions au compte de l’Etat, cela nous a donné l’opportunité de représenter le pays à des instances telles que les Conventions des partis (COP), notamment la Convention de Minamata sur le mercure, où j’ai occupé le poste de point focal de 2018 à 2023. Cela m’a donné l’opportunité de représenter l’Afrique pour les quatrième et cinquième conférences de partis sur Minamata, notamment la COP4 et la COP5, qui se sont tenues respectivement à Bali en Indonésie et à Genève en Suisse.
S : En tant que directeur de la promotion de l’éducation environnementale et de l’écocitoyenneté, quelles étaient vos principales missions ?
R.B. : Quand on entend éducation environnementale, certains m’avaient transformé en enseignant. Quand je suis arrivé à ce poste, 60% du personnel venait du monde de l’éducation et mes deux chefs de service étaient des inspecteurs de l’enseignement primaire et secondaire. Avec leurs contributions, nous avons travaillé à mettre en œuvre la politique du département en matière de promotion de l’écocitoyenneté. L’écocitoyenneté, c’est travailler à donner à chaque citoyen le réflexe écologique. Notamment, ne pas jeter un sachet vite après usage, ne pas jeter des déchets à terre, ne pas couper des arbres, prendre soin de son cadre de vie. On a travaillé avec toute l’équipe et le ministère en charge de l’éducation pour avoir un arrêté portant mise en place et fonctionnement des clubs écologiques dans les lycées et les collèges qui a été signé en décembre 2017. Cela a été une victoire parce que pour vous raconter l’anecdote, c’est un dossier qui était dans le tiroir, il y a longtemps. Selon un des anciens ministres qui disait que quand ils ont essayé de faire aboutir le dossier, il s’est trouvé qu’il y avait un ministre dans le gouvernement qui était du bord écologique, mais qui n’était pas de la mouvance.
Nous avons également le point focal au niveau des changements climatiques, point focal, chargé de l’information et de la sensibilisation de la population à la question. Dans ce sens, nous avons créé un réseau au niveau de l’Afrique avec certains pays pour travailler sur la question d’information et de sensibilisation pour changer la conscience des acteurs. Il y avait des guides pour les encadreurs pour l’éducation environnementale. Nous avons travaillé à les multiplier et à les diffuser auprès des utilisateurs, notamment les ministères de l’éducation. On a travaillé également à faire des sensibilisations dans toutes les 13 régions sur les questions d’orpaillage et de la pollution plastique. Ainsi, nous avons formé près de 550 conseillers municipaux et régionaux sur cette thématique.
Pour terminer, nous avons, en collaboration avec les premiers responsables de la RTB, mis en place une émission sur l’environnement chaque mardi à la télévision nationale, dans « RTB matin » devenu « Fôfô ». L’émission se poursuit jusqu’à présent.
S : Vous avez été vice-président des Conférences des parties à la convention de Minamata sur le mercure. Pouvez-vous nous citer quelques résultats engrangés au cours de votre mandat ?
R.B. : A ce poste, je représentais l’Afrique en compagnie du Botswana. Au lieu d’un mandat, nous avons fait deux. Donc, nous avons fait les COP 4 et 5. Nous avons pu créer un réseautage entre l’Afrique et les autres parties. Parce que à la COP, il y a plusieurs parties, donc il y a l’Afrique, il y a les Etats-Unis, il y a l’Amérique, ainsi de suite. Nous avons ainsi organisé et préparé toutes les réunions internationales, souvent avec des réunions en ligne et la majeure partie du temps en anglais. Pour les négociations à la COP 4 à Bali, nous avons pu faire adopter une disposition qui réglementait l’utilisation de l’amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans et les femmes allaitantes. Ce n’était pas un acquis.
Egalement sur les questions des dispositifs de l’éclairage, nous avons convenu sur une période pour retirer les lumières qui contiennent du mercure. Parce que le mercure, ce n’est pas uniquement la question de l’extraction de l’or. Dans les ampoules, les thermomètres et dans de nombreux dispositifs, il y a du mercure. Dans les pays développés, ce sont des technologies obsolètes qu’ils ont abandonnées. Mais le continent africain devient le continent refuge de ces technologies. Donc, nous profitons de ces conventions pour travailler à mettre chaque partie du monde à équité. Si on peut utiliser une telle technologie dans un autre continent, on peut le faire en Afrique aussi. Il ne faut surtout pas dire que c’est trop cher parce que la santé n’a pas de prix. En tous les cas, nous avons rendu fière l’Afrique avec le mandat que nous avons tenu.
S : Le Burkina Faso perd en moyenne, 243 450 ha de forêt. Quelle réponse apporte votre département à cette situation ?
R.B. : Pour notre département, c’est vraiment une préoccupation. Même sans statistiques, le constat sur le terrain est alarmant. Car la couverture forestière de notre pays est en nette régression. De 2000 à 2022, le pays a perdu presque deux millions d’hectares de sa superficie forestière. Pour inverser cette tendance, mon département travaille à réduire la pression sur les ressources forestières à travers les sensibilisations, l’organisation des acteurs de gestion des ressources forestières, l’aménagement de certaines forêts mais aussi la répression des contrevenants. Aussi, le ministère est déconcentré jusqu’au niveau des départements où nous avons des répondants pour prendre en charge la thématique de la protection et de la préservation de nos ressources forestières.
Toutefois, vous conviendrez avec moi que le personnel forestier n’est pas assez étoffé pour prendre en charge tous les défis qui se présentent. C’est pourquoi, l’Etat a autorisé de recruter 4 000 assistants des eaux et forêts, pour renforcer les opérations de surveillance de nos massifs forestiers. On a déjà recruté 1 950 agents, qui seront opérationnel à partir de mars 2025. Il y a 1 300 qui sont en cours de recrutement, pour la rentrée prochaine. Là, on va compléter l’effectif pour permettre de travailler, d’abord à avoir des techniciens capables de mener les campagnes de reforestation et ensuite pour la sécurisation des forêts.
Un autre pan de notre bataille est l’immatriculation de nos forêts. Nous avons de nombreuses forêts, mais il y a le problème des statuts. Pour parler de forêt, il faut qu’elle soit immatriculée. A ce niveau, on a des difficultés, mais on travaille à immatriculer nos forêts, parce que sur les 76 aires classées au Burkina Faso, seulement 15 sont immatriculées, à nos jours. Sur les quinze, neuf ont été immatriculés entre 2022 et 2024. L’immatriculation de toutes nos forêts classées demeure donc un challenge qu’il faudrait relever pour mieux sécuriser nos forêts. Egalement pour les forêts, il faut un plan d’aménagement forestier. Donc, on ne peut pas travailler à pérenniser les forêts qui n’ont pas ce plan. Nous travaillons à avoir des plans d’aménagement forestier dans toutes les forêts. En 2024, au moins quatre plans d’aménagement forestier seront élaborés.
Nous avons aussi un projet très important actuellement, le projet de gestion des paysages communaux, pour la REDD+, qui va intervenir dans 96 communes. On a commencé dans 30 communes où les zones d’intervention prioritaires sont les espaces de conservation que sont les forêts-villages. En début septembre, on était sur le terrain où on a pu voir comment ils sont en train de récupérer certaines forêts classées, très dégradées, pour que ce soit des zones de production et de conservation.
Egalement, on continue de travailler sur la Régénération naturelle assistée (RNA), parce qu’il y a plusieurs technologies dont la RNA et les reboisements, pour permettre d’avoir un couvert végétal à hauteur de nos ambitions. Il y a aussi des actions pour informer la population à diminuer l’utilisation du bois de chauffe. Parce que si vous ne mettez pas une politique d’information et des alternatives, on va beau planter, cela va répartir dans le bois de chauffe. Pour juguler tout cela, il faut mettre un cadre organique très opérant, avec des interventions qui peuvent se pérenniser. C’est pourquoi, il a été institué la Journée nationale de l’arbre(JNA) depuis 2018, qui permet de mobiliser tous les acteurs sous le leadership du chef de l’Etat pour que ces questions soient bien prises en charge. Avec la nouvelle dynamique, nous avons institué ce que nous appelons l’initiative « Bataille pour le renforcement de la couverture végétale (BARCOUVE) ». Parce qu’il s’agit de domaines classiques. On plante les arbres du temps de nos grands-parents, on va toujours planter, mais pour attirer les acteurs, il faut innover. C’est pourquoi nous avons déclenché la BARCOUVE, une innovation qui va venir après d’autres innovations et apporter sa part de contribution.
S : Sidwaya a récemment fait une enquête dans le Kénédougou où il y a un trafic de bois d’œuvre surtout dans les localités difficilement accessibles du fait de l’insécurité. Qu’est-ce qui est envisagé pour y faire face ?
R.B. : Avant cet entretien, j’ai lu votre reportage. Dans la zone de Koloko à la frontière avec le Mali, notamment. Actuellement, avec l’insécurité, il y a des abus qui sont constatés sur le terrain, mais nous travaillons à les minimiser. C’est pourquoi, on vous a parlé d’un recrutement important d’agents des eaux et forêts pour faire face à toutes ces situations. Récemment, on était sur le terrain, au compte du gouvernement, pour sensibiliser la population, et on a passé le message suivant : « Oui à la lutte contre le terrorisme, non à la destruction de nos forêts ».
Aussi, le processus d’apurement des forêts lancé depuis quelques années continue de faire ses preuves avec l’apurement de cinq (05) forêts en 2023 et une projection de 10 forêts à apurer cette année 2024. Il faut cependant reconnaitre que la consolidation des acquis de ces apurements s’avère nécessaire et c’est ce à quoi s’attèlent les services déconcentrés et les unités combattantes à travers une surveillance accrue desdites forêts.
S : Dans la région du Sud-Ouest, l’une des causes principales de la disparition des forêts est l’orpaillage. A votre niveau, qu’est-ce qui est fait ?
R.B. : L’orpaillage est défini dans le nouveau Code minier comme l’extraction artisanale de l’or. Pour résoudre ce problème, nous avons plusieurs étapes à franchir. La première, au-delà de la région du Sud-Ouest, nous travaillons avec le ministère en charge des mines pour extraire les forêts classées du cadastre minier. En terme simple, si vous voulez un permis d’exploitation ou un permis de recherche minière, on ne peut plus vous donner une autorisation tant que votre permis est dans une forêt classée. Nous sommes donc en train de finaliser ce travail pour extraire les forêts classées du cadastre minier.
La deuxième étape c’est qu’il faut changer de paradigme. L’orpaillage, dans son essence, c’est ce qu’on fait de manière discontinue sur un territoire donné, à la recherche de l’or, par des moyens rudimentaires. Il faut qu’on élève le niveau pour que les gens se transforment en petites mines, en semi-mécanisées, où ils ont un espace qui est défini et peuvent travailler selon la réglementation qui existent. Pour aller dans ce sens, la Société nationale des substances précieuses (SONASP) est à pied d’œuvre pour encadrer les acteurs. Il y a déjà des exemples d’artisans miniers organisés au Sud-Ouest avec l’aide de la SONASP et de certains partenaires comme Artisanat Gold Council avec le projet Planet Gold, où sur un hectare, ils ont mis un système de traitement de l’or sans mercure. Il faut donc que les artisans miniers travaillent en coopérative et non de manière individuelle pour pouvoir juguler le problème. L’ambition c’est donc d’aller aux petites mines semi-mécanisées, l’extraction des forêts classées du cadastre minier pour faire un bond qualitatif dans la protection des forêts.
S : La forêt de Kua était menacée de destruction pour faire place à l’hôpital de référence en construction à Bobo-Dioulasso. Y a-t-il des garanties que cette forêt sera préservée, surtout qu’elle fait désormais face à l’hôpital ?
R.B. : Nous remercierons tout d’abord tous les acteurs qui de près ou de loin ont œuvré à ce que nous puissions encore parler de cette forêt. Pour revenir à votre question, il faut dire que la forêt de Kua (350 ha) a été classée en 1936 par le gouverneur général de l’Afrique occidentale française au même titre que les forêts de Kuinima et de Dindéresso. Aujourd’hui, ces trois forêts, en plus de la FC du Kou, sont dites péri-urbaines de Bobo Dioulasso et jouent un rôle crucial quant à la séquestration de carbone de la deuxième plus grande ville du pays. Elles constituent un « poumon vert » en plus de leur rôle écologique et ne sauraient être un frein au développement socio-économique de la région des Hauts-Bassins. Cette conciliation nous permet de parler d’ailleurs de développement durable.
Nous pouvons donc affirmer que la cohabitation spatiale avec l’hôpital ne saurait être un danger pour la FC de Kua du fait de l’existence d’un cadre juridique règlementaire, mais aussi et surtout des multiples campagnes de sensibilisation des populations en amont de la mise en œuvre du projet de construction de l’édifice.
Aussi, il est prévu l’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan d’aménagement de la Forêt qui prévoit son érection en parc urbain et la réalisation d’un mur sur tout le périmètre de la forêt à travers le projet d’Appui à la Gestion Durable des Ressources Forestières (AGREF). Ainsi il y aura des espaces récréatifs, de jeux, d’éducation environnementale, etc. Les investissements prévus sont évalués à plus de 1,7 milliard FCFA.
S : La Journée nationale de l’arbre (JNA) est une des activités phares de votre ministère. Après 5 éditions est-ce qu’il y a des motifs de satisfaction ?
R.B. : Il y a des motifs de satisfaction et d’aller plus loin. Parce que chaque édition est placée sous le très haut patronage du chef de l’Etat. Pour la question de l’arbre, la plus haute autorité se mobilise. Donc, c’est déjà un motif de satisfaction. Dans la satisfaction aussi, il y a des chiffres. Parce que pour les 5 dernières années, on a planté chaque année au moins 6 millions de plants. Quand on dit 6 millions de plants, dans la JNA, il y a deux composantes : la JNA elle-même et la campagne nationale de reforestation. La Journée nationale de l’arbre, c’est pour faire une fixation en un jour sur des espaces que l’Etat même a définis, sécurisés et plantés. Quand on fait nos points, on s’attarde plus sur les sites JNA qui sont tous clôturés, qui ont un point d’eau et qui sont entretenus avec un taux de réussite des plants très fort appréciable. Egalement, on profite de ces JNA pour remercier et féliciter les acteurs. Pour les 5 ans, c’est près de 60 millions F CFA qui ont été remis à nos lauréats. On met les régions en compétition, on met les communes en compétition, les associations, pour voir ceux qui ont fait des activités de reboisement qui ont le plus réussi. En plus, on a la reconnaissance de la nation à l’endroit de 85 acteurs qui œuvrent dans la préservation de l’environnement à travers des distinctions honorifiques.
Pour cette année 2024, on a apporté encore des innovations avec ce que nous avons appelé « Three Nights », la nuit de l’arbre ou de l’engagement, où des acteurs sont venus s’engager pour le reboisement. A l’occasion, nous avons noté 211 engagements qui sont en train d’être mis en œuvre. Au 31 décembre, nous allons faire le point.
Dans cette dynamique des innovations en 2024, on a lancé des concepts comme « Mon institution, mon entreprise, mon bosquet », qui ont pris dans l’opinion par rapport à ce que nous voyons dans l’actualité. On a même une effigie avec le chef de l’Etat qui dit « Mon institution, mon bosquet ». On a une autre effigie avec le parrain de cette édition qui dit : « Mon entreprise, mon bosquet ». La population a adhéré à ces initiatives et nous sommes est en train de faire le point pour voir ce qui a changé avec ces innovations et comment on peut aller à l’échelle en 2025.
Il faut noter aussi l’institutionnalisation du Prix Yacouba Sawadogo pour la reforestation qui reconnait les mérites des acteurs, que ce soit des personnes physiques ou morales chaque année, sur leurs actions en faveur de l’environnement.
S : Habituellement la JNA est fixée au mois d’août. Pour la présente édition, elle a été célébrée le 22 juin passé. Quelles explications donnez-vous à ce changement de période ?
R.B. : La VIe édition de la JNA qui a consacré également le lancement officiel de la campagne de reforestation 2024 a été fixée, le 22 juin 2024, pour tenir compte de l’installation précoce de la saison des pluies dans certaines zones du pays. Cela permettra aux plants mis en terre de bénéficier du maximum de pluies pour une meilleure reprise. Cela a été décidé pour que les plans soient autonomes, qu’on n’ait pas besoin de faire des arrosages après la saison de pluie. Nous sommes aussi en train d’engager ce qu’on appelle le reboisement hors saison. On va commencer en octobre pour compléter nos statistiques sur la voie de contournement.
S : Avec le contexte sécuritaire, certaines forêts sont devenues un lieu de refuge pour des terroristes. Quel point pouvez-vous faire de la situation dans ces zones ?
R.B. : Merci bien pour l’intérêt que vous portez à la sauvegarde des aires classées du pays. Votre constat est juste. Aujourd’hui, de nombreuses forêts servent de refuge aux terroristes et d’autres de corridor de trafic de tout genre. C’est au regard de ce constat, que nous avons entrepris le processus de réorganisation du dispositif du Cadre paramilitaire des Eaux et Forêts courant 2023 afin de répondre efficacement aux impératifs de la sauvegarde des ressources naturelles, mais aussi et surtout, de la sécurisation du territoire national. Cette réorganisation commence déjà à produire des résultats satisfaisants au nombre desquels nous avons l’apurement progressif des forêts des zones d’intervention des unités déployées.
S : Nous avons assisté à la dissolution de l’unité spéciale des Eaux et forêts. Qu’elle en est la raison ?
R.B. : Effectivement, le 28 février dernier, le Conseil des ministres a prononcé la dissolution de l’unité spéciale d’intervention des eaux et forêts. Il faut dire que ce n’est pas une décision isolée. Elle est la conséquence de ce que nous avons appelé de l’insubordination caractérisée telle que définie par le Code de règlement des disciplines générales et de déontologie des Eaux et Forêts qui organise les activités du corps.
Qu’est-ce qu’il s’est passé ? En fait, l’unité spéciale qui a été mise en place a été envoyée en mission de sécurisation dans une zone du pays. Elle a désobéi à l’instruction de sa hiérarchie pour conduire la mission. Donc, elle a regagné Ouagadougou et a pris en otage le directeur général chef de corps au sein de la Direction générale et empêchant tout mouvement hors du service. Ce n’est pas tolérable. Ce n’est pas nous qui le disons, c’est le Code de discipline qui le dit. Et les articles sont très précis à ce niveau. Donc, on a demandé un compte rendu de la hiérarchie qui a fait le point. Le compte-rendu a été envoyé au Conseil des ministres qui a estimé qu’il n’y a aucune raison qui puisse justifier cette prise d’armes et la séquestration du chef de corps. Après la dissolution, des éléments ont été identifiés comme des meneurs. Ce n’est pas toute l’unité spéciale qui compte 260 éléments. C’est plutôt une section. Ils ont été traduits en conseil de disciplines et il y aura des sanctions individuelles.
S : Ont-ils été radiés ?
R.B. : Pour cette question, les infractions sont très bien notifiées dans le Code. Conformément aux dispositions du règlement des disciplines générales et de déontologie du corps paramilitaire des eaux et forêts, il pourrait y avoir des sanctions dont des blâmes, des abaissements d’échelon, des mises en demeure, des radiations.
S : Des espèces protégées, surtout les éléphants, causent de nombreux dégâts dans des champs et ce n’est pas nouveau. Comment votre département arrive à apaiser les cœurs de ces agriculteurs et assurer en même temps la protection de ces animaux ?
R.B. : La mise en œuvre du décret portant conditions et modalités de réparation des dommages causés par certaines espèces animales sauvages au Burkina Faso permet à mon département d’assister les producteurs victimes et assurer en même temps la protection de ces animaux.
Ce décret a prévu des réparations qui consistent à verser en espèces, une indemnisation compensatrice des pertes subies par la victime, sur la base d’une évaluation faite par la commission de réparation mise en place par le chef de circonscription administrative le plus proche. Depuis l’entrée en vigueur de ce décret, l’Etat parvient à respecter ses engagements ce qui soulage les différentes victimes des dommages causés par certaines espèces de faune. A titre illustratif, 1 140 victimes ont été indemnisées à hauteur de plus de 423 millions FCFA depuis 2017.
S : Du fait du terrorisme, certaines zones cynégétiques tendent à perdre leurs lustres d’antan. Que prévoit votre département pour restaurer ces sites ?
R.B. : Pour ces questions, le premier lundi du mois de juillet, on a annoncé avec les collaborateurs que le deuxième semestre de l’année, sera le semestre de la faune. Parce qu’on a senti qu’il y avait une certaine latence dans ce domaine. Les services compétents viennent de me transmettre les plans d’action pour booster nos réserves fauniques. Le domaine va encore exister parce qu’on a des projets qu’on est en train de mûrir avec des partenaires sur le complexe W, parc d’Arly, parc de Pendjari (WAP), qui est frontalier avec le Bénin et le Niger. Avec les propositions, des actions seront examinées et mises en œuvre pour donner espoir. On a aussi commencé à élaborer une fiche de projet pour la restauration de ces zones après la crise, pour travailler à redorer l’économie nationale à ce niveau.
S : Il est prévu dans la période de 2016 à 2027, la création de 2 000 éco-villages au Burkina Faso. A ce jour où en est-on avec le projet ?
R.B. : Pour les éco-villages, ce n’est pas facile. Effectivement mon département abrite la coordination de l’initiative de création de 2 000 éco-villages. Ces 2 000 villages à transformer en éco-villages ont été identifiés depuis 2017 dans les 13 régions à travers un processus participatif et inclusif. A ce jour, le processus suit son cours. Nous sommes à 73 villages en transformation qui ont un niveau de transformation plus ou moins avancé. Il faut dire qu’il s’agit d’un long processus qui nécessite beaucoup d’efforts de financement. Le gouvernement y contribue à travers le financement d’un projet de transformation de 45 villages dont un village par province. D’autres projets sont en cours de conception pour soutenir la mise en œuvre de l’initiative qui est l’affaire de tous, chacun devant contribuer selon ses moyens et ses attributions pour le mieux-être des ménages ruraux.
On a quelques exemples de villages en transformation en éco-villages notamment Tanlarghin dans la commune de Saaba ; Béta dans la commune de Ziniaré ; Basgana dans la commune de Manga. A ce jour, le budget investi dans la mise en œuvre de l’initiative 2 000 éco-villages est d’environ deux milliards FCFA. Le budget nécessaire pour la transformation d’un village en éco-village est de 800 millions de franc CFA au minimum. On a donné des orientations pour qu’on change l’angle d’approche avec des modèles de villages autonomes sur plusieurs plans. L’objectif c’est la maitrise de la question énergétique, la question de l’eau, la gestion des déchets, de la pollution.
S : La mise en place de ces éco-villages nécessite un changement de comportement de la population. Comment ont-elles accueilli ce projet dans les villages dits pilotes ?
R.B. : Il y a eu beaucoup d’engouement. Et cela s’est ressenti dans le processus d’identification des villages. Les populations participent aux activités de transformations de leur village. Ce sont elles mêmes qui choisissent les types d’investissements et mènent certaines activités comme la construction de pistes rurales, la construction d’infrastructures sous forme de haute intensité de mains d’œuvre.
S : L’une des missions de votre département, c’est d’assurer la transition du pays vers une économie verte et inclusive. De quoi exactement s’agit-il ?
R.B. : L’économie verte est un concept, un modèle de développement qui tient compte de l’environnement et qui le considère comme une opportunité. A titre d’exemple, en matière d’économie verte, les déchets ne doivent pas devenir un problème. Ils sont des opportunités avec la filière déchets. De la collecte à la valorisation, on crée des emplois tout en préservant l’environnement.
S : La question de l’interdiction des sachets plastiques continue d’animer les débats. Quelle est la position de votre département concernant ce sujet ?
R.B. : La problématique des sachets plastiques est une question d’intérêt national. Elle concerne aussi bien l’amélioration du cadre de vie des populations que la protection de la santé et de l’hygiène publique.
En rappel, le 20 mai 2014, notre pays a adopté la Loi N° 017 portant interdiction de la production, de l’importation, de la commercialisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables et certains textes d’application. A cet effet, des actions ont été entreprises pour l’application de cette loi. Malgré des efforts déployés çà et là, force est de constater que l’état du cadre de vie dans nos villes et campagnes reste préoccupant du fait de la propagation continue des déchets d’emballages en plastique.
Cela s’explique par exemple par le caractère partiel de l’interdiction, la longue durée de vie des emballages biodégradables soit au moins 5 ans dans la nature, l’impossibilité pour les citoyens et même pour les techniciens de distinguer avec certitude les emballages et sachets biodégradables de ceux qui ne le sont pas sans recours à des appareils spécifiques. Face à cette situation, il est normal que la question continue d’animer les débats. Alors, ce qu’il convient de faire, c’est d’aller à la relecture de la présente loi 017. Et, c’est ce à quoi mon département s’attelle présentement. D’ores et déjà, je précise que c’est un processus qui a commencé depuis 2019 et se poursuit.
Dans le processus de relecture de la loi, nous sommes restés en contact avec les acteurs du plastique. Nous avons tenu des concertations avec ces acteurs pour recueillir leurs avis et préoccupations. Ces concertations ont abouti à la validation de l’avant-projet de loi et son examen par le COTEVAL, le 23 aout 2024. Il reste sa soumission en Conseil des ministres pour la suite de la procédure.
Nous tenons à rassurer les acteurs que seuls les emballages et sachets plastiques les plus problématiques sont visés pour interdiction principalement ceux à usage unique ou jetables. Des dérogations permettront à certains acteurs de poursuivre les activités conformément à la règlementation.
S : En attendant, les sachets plastiques se retrouvent partout. Que faut-il faire ?
R.B. : Il y a un peu d’incivisme qui amplifie la problématique. Les résidus des sachets plastiques doivent être dans les décharges officielles et pas partout dans les quartiers. Si chaque citoyen, après avoir utilisé un emballage plastique, le mettait dans une poubelle, il va être retrouvé dans une décharge officielle. Les dispositions sont prises pour que tout résidu ne soit pas nocif à son environnement. C’est d’ailleurs pour cela qu’on veut retirer ces sachets non biodégradables de la circulation au profit des emballages qui ne posent pas de problème à la santé et à l’environnement.
Je profite de l’occasion pour attirer l’attention sur les kits blancs. En général, ces kits sont faits en polystyrène. C’est du plastique. Le styrène c’est un gaz. Dans la chimie, le polystyrène, c’est plusieurs molécules de styrène. Quand vous mettez du repas chaud dans un emballage en polystyrène, il dégage le styrène. Au contact de la chaleur le styrène devient comme du sel pour votre repas et va dans votre organisme. A la limite, on peut mettre des repas froids. Ailleurs, ces kits ne sont pas utilisés. Mais quand on va interdire ces kits, on va vous demander comment vont faire les gens ? Mais quand vous devez calculez le coût de l’inaction, vous vous rendrez compte qu’il faut interdire. De plus, ces kits ne sont pas réutilisables et ne se dégradent pas. Ailleurs, on va vous servir dans les emballages en papier. Avec le papier, ce n’est plus forcément les arbres qu’on abat parce que les acteurs ont changé de paradigme. C’est le système de recyclage.
Pour juguler tous ces problèmes, avec le Fonds d’intervention pour l’environnement, nous avons lancé des appels à projets à hauteur de 750 millions F CFA comme des subventions pour des associations qui vont faire la valorisation des déchets et qui vont proposer des alternatives au plastique. D’ici là, ils vont diffuser la liste et le processus doit continuer pour que ce soit pérenne.
S : Face à cette question de plastique qui est vraiment préoccupante, quel est le choix réel du gouvernement. Est-il interdit ou pas ?
R.B. : Le Conseil des ministres va se prononcer. Le ministère de l’Environnement, après avoir consulté tous les acteurs, a introduit le dossier en Conseil des ministres. A la sortie du Conseil des ministres, vous allez connaître la position du gouvernement.
S : Le Burkina Faso, pays vulnérable aux effets des changements climatiques, a ratifié des conventions internationales (Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques, le Protocole de Kyoto…) en vue de la réduction des gaz à effet de serre. Comment votre département exécute cette politique sur le terrain ?
R.B. : Nous préparons même les trois Conférences des partis (COP), celles sur la biodiversité en octobre prochain, sur le changement climatique en novembre et sur la désertification en décembre.
Le Burkina Faso à l’instar des autres pays vulnérables contribue à l’effort mondial de réduction des émissions à travers des actions inscrites dans leur Contribution déterminée au niveau national (CDN). En effet, le Burkina Faso a soumis sa CDN révisée en 2021 avec une ambition de réduction de ses Gaz à effet de serres de 15,87% en 2025 et 29,42% à l’horizon 2030. Par ailleurs, le pays a élaboré en 2021 sa stratégie de développement à faible émission de carbone et résilient au climat.
Concrètement, la participation du Burkina Faso à ces conventions a permis entre autres de 2016 à nos jours de créer ou renforcer des partenariats bilatéraux et multilatéraux, d’adhérer à des initiatives pour la préservation de l’environnement et pour le Développement durable ; de mobiliser des ressources financières estimées à plus de deux cents (200) milliards FCFA pour le financement de 25 projets et programmes et des initiatives de développement durable dans le domaine des changements climatiques ; de mobiliser plus de 42 milliards FCFA à travers le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) en faveur de la diversité biologique. Pour ce même fonds, nous venons de mobiliser des fonds pour les plastiques appelé IP plastique (Initiatives pour éliminer l’utilisation de plastique dans la chaîne agroalimentaire) à la suite d’un appel à projet. Le Burkina qui a postulé a été retenu avec 15 autres pays. Et le projet commence en janvier 2025 avec 3 milliards F CFA de subvention.
S : Dans le cadre de la Convention cadre des Nations unies pour les changements climatiques, des puissances comme les USA boudent par exemple, l’accord de Paris. Cela ne sape-t-il pas les efforts de la communauté internationale sur les changements climatiques ?
R.B. : On parle maintenant de diplomatie environnementale. Cela veut dire que c’est très politique. Donc, chacun doit s’armer pour aller se défendre. Chaque pays est vraiment souverain pour défendre ses points de vue. Le Burkina fait partie des pays les moins avancés et le groupe de 77 plus la Chine. Donc, nous partons en négociation en groupe, parce que nous sommes victimes. Certains pays ont leur vision et nous travaillons à chaque COP pour leur faire changer de vision, les aligner sur les objectifs que toute la communauté a arrêtés. Mais malgré tout, les mécanismes avancent. Certains pays ne ratifient pas certaines dispositions, mais ils participent à toutes les réunions. Cela veut dire que c’est important. Mais, ce sont des questions économiques, politiques. Sauf que pour la question des changements climatiques tout le monde est d’accord que c’est une réalité et qu’on peut travailler à diminuer les impacts.
S : Vous avez dit que le Burkina et les autres pays vont en groupe parce qu’ils se ressemblent. Quelle expérience alliez-vous partagez à la prochaine COP ?
R.B. : Le Burkina Faso participera à la 29e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 29), qui se tiendra, du 11 au 22 novembre 2024 à Bakou, en Azerbaïdjan. Pour les travaux techniques, 12 thématiques clés et d’intérêt ont été identifiées pour notre pays que sont entre autres : la Finance, l’Adaptation, l’Atténuation, la Transition juste, le Bilan mondial, le Développement et le Technologie, le Renforcement des capacités, la Transparence, l’Article 6 de l’Accord de Paris relatif au marché du carbone, les Pertes et Préjudices liés aux impacts néfastes des changements climatiques, le genre et l’agriculture. Des experts travaillent sur ces thématiques pour que les préoccupations de notre pays soient prises en compte dans les différentes instances de décisions.
Cette COP-29 qui s’inscrit dans la dynamique d’une ambition plus accrue pour un monde décarboné, est essentielle pour le Burkina Faso. Les expériences et bonnes pratiques développées au Burkina Faso en matière d’adaptation et d’atténuation seront mises en exergue. La COP-29 également sera mise à profit pour le développement de partenariats pour l’atteinte des objectifs de la Transition comme l’Offensive agricole du Burkina Faso, le développement de marché carbone pour faciliter le financement des projets et technologies sobres en carbone et résilient au climat, le partenariat pour la recherche scientifique.
S : La gouvernance environnementale et le développement durable sont aussi un cheval de bataille de votre département. Comment se traduisent-ils de façon concrète ?
R.B. : Nous partageons la question du développement durable avec d’autres départements tels que le ministère de l’Economie et des Finances qui a une direction générale de l’économie et de la planification. Parce qu’à la fin, ce sont des questions économiques. Nous nous occupons des questions qui ont un lien avec l’environnement et les modes de consommation et de production durable. De manière opérationnelle, plusieurs actions sont menées comme le renforcement des capacités des cellules environnementales qui sont instituées dans les ministères, les structures privées et les collectivités comme garant de la prise en compte des questions d’environnement et de développement durable. Ces cellules ont été instituées par un décret de 2007, mais il est en relecture.
Nous organisons aussi la Conférence nationale du développement durable qui se tient de manière régulière sous la présidence du Premier ministre. La 5e session va se tenir cette année, du 28 au 29 novembre, pour faire le point. Cette instance se tient chaque 2 ans. Mais, il y a eu des difficultés avec les péripéties que nous avons traversées. Nous voulons partir d’un bon pied à partir de novembre 2024.
Il y a également la célébration des Journées mondiales en faveur du développement durable , la Journée mondiale de l’environnement, la Journée de la biodiversité, la Journée de la désertification, la Journée ozone, la Journée sur les zones humides. Ce sont autant de journées qui sont célébrées dans le continuum du développement durable. Il y a également la production des rapports sur l’état de l’environnement de manière périodique et à ce jour, nous avons élaboré quatre rapports. Ces rapports font le diagnostic sur l’état de l’environnement au niveau national et les perspectives pour l’améliorer.
Au compte de ces accords multilatéraux en matière d’environnement, depuis les 5 dernières années, de manière globale, nous avons pu mobiliser près de 42,1 milliards F CFA pour injecter directement dans la question du développement. Même dans les attributions des membres du gouvernement qui ont été adoptées, le 2 septembre 2024, au niveau de certains ministères comme le ministère des finances, nous avons noté la mobilisation de la finance climatique à laquelle nous sommes chargés de contribuer.
S : Depuis votre arrivée à la tête du département la Ceinture verte de Ouagadougou connait un certain nombre de transformations. Quel va être désormais le statut de cet espace ?
R.B. : Dans notre pays, le projet Ceinture verte de Ouagadougou (CVO) a été initié en 1974 par le gouvernement burkinabè et sa mise en place a commencé en 1976. Une ceinture verte, par définition, est un espace occupé par des formations végétales naturelles ou artificielles, situées à la périphérie des villes et poursuivant des objectifs de préservation de l’environnement, de délimitation et d’approvisionnement en produits forestiers ligneux. La Ceinture verte est soumise au régime juridique des forêts. Elle doit faire l’objet d’un classement au nom de l’Etat ou des collectivités décentralisées. Un plan d’aménagement est en cours d’élaboration par mon département avec l’implication de tous les acteurs concernés. Il définira une vision et des modalités d’aménagement et de gestion de cette ceinture verte dans le contexte actuel. La CVO est actuellement sous une très grande pression anthropique. En effet, une étude réalisée en 2017 et actualisée en 2022 donne plus de 1 344 sites d’occupation repartis entre 34 types avec un taux d’occupation de 31,29% mais si nous considérons les sites maraichers comme une occupation, le taux passe à 42,62% sur une superficie, selon la BNDT 2012 de 2 559,73 ha.
S : Quelle est la limite de cette Ceinture verte, car jusqu’à présent, des populations disent qu’elles ne savent même pas qu’elles sont installées sur cette Ceinture ?
R.B. : C’est pourquoi, il y a un plan d’aménagement en cours. Dès que le plan va finir, on va procéder au bornage. Cette ceinture fait le tour de la ville, de Polesgo, à partir de la zone industrielle, entre la zone industrielle et la mairie de l’arrondissement 4. Elle passe à côté du séminaire de Kossoghin pour continuer à Pissy, au quartier Zongo qui va faire le tour vers la présidence Kossyam. La ceinture verte est anthropisée. Lorsqu’ on va faire le plan d’aménagement, nous allons faire le point pour savoir quels sont les types d’anthropisation et leurs retombées pour le pays.
S : Il est de plus en plus question de nucléaire au Burkina Faso. Votre ministère est-il impliqué dans les différents projets ?
R.B. : La question du nucléaire, depuis longtemps, était un peu réservé à une élite qui n’arrive pas à se convaincre elle-même souvent parce que c’est gardé entre eux. Pour la question du nucléaire, certains pays sont verrouillés sur le système diplomatique. Pourtant, c’est une technologie qu’il faut dompter, tout simplement. Le Burkina est en avance parce que nous avons l’Autorité de radioprotection et de sécurité nucléaire qui a travaillé et il y a une loi qui existe depuis 2012 pour gérer ces questions. Il n’y a pas longtemps, le Conseil des ministres a adopté un rapport sur l’exposition des acteurs pour certains types de rayonnements.
C’est dire que sur la question, notre département est bien impliqué. C’est d’abord, avec les orientations du chef de l’Etat, qu’il a été créé l’Agence de l’énergie atomique qui est rattachée à la Présidence, qui va travailler à nous apporter assez d’énergie pour nos activités.
La protection de l’environnement et la protection radiologique de la population sont de grands défis dans toutes les étapes du projet. La contribution du ministère dans le présent projet se fait à deux niveaux. La réglementation des activités du projet à travers l’Autorité nationale de radioprotection et de sûreté nucléaire (ARSN) et les aspects environnementaux du projet, notamment le choix du site à travers les aspects environnementaux qui doivent être pris en compte et une étude d’impact environnemental doit être faite. La construction à travers un suivi environnemental qui doit être fait pendant toute la phase de construction et l’exploitation. Pendant la phase d’exploitation, les aspects environnementaux existent également : gestions des déchets produits par la centrale, la surveillance radiologique de l’environnement.
Il y a des rapports annuels qui sont transmis au niveau international. Pour le moment, il n’y a pas de problème. Et avec l’Agence internationale de l’énergie atomique ainsi que nos partenaires, nous travaillons pour avancer sur ce dossier.
S : Depuis 2018, le Burkina Faso n’importe plus le mercure du fait de son impact négatif sur l’environnement. Malheureusement, les sites d’orpaillage sont inondés de cette substance. Est-ce une incapacité à empêcher l’entrée de cette substance sur le territoire national ?
R.B. : Officiellement, je n’ai pas connaissance d’une quelconque autorisation ou avis délivré dans le cadre de la procédure d’importation du mercure. A cet effet, le mercure utilisé sur les sites d’orpaillage rentre de manière illicite du fait certainement de la porosité de nos frontières.
Il faut donc s’attaquer au commerce illicite de mercure. Des dispositions sont prises et d’autres en cours en vue de lutter contre ce trafic illicite, il s’agit notamment des séances de renforcement des capacités des acteurs de contrôles sur les techniques de détection et de contrôle du mercure et des produits contenant du mercure ajouté et de la promotion de technologie de traitement de l’or sans mercure à travers le projet PlanetGold.
C’est pourquoi on travaille à proposer des alternatives au traitement de l’or. Le mercure est utilisé pour le traitement individuel de l’or. Si on passe aux semi-mécanisés, aux petites mines et aux coopératives, on va trouver d’autres substances chimiques autorisées avec des techniciens formés.
S : Les grandes villes du pays sont confrontées à des problèmes d’assainissement avec leurs lots de maladies comme la dengue et le paludisme. Que fait votre département pour résorber le problème ?
R.B. : Ce sont des difficultés réelles. Mais souvent, on fait un transfert systématique à l’Etat. Il faut que tous les acteurs s’impliquent parce qu’en matière d’assainissement, il y a un minimum. Pour les cas des latrines, il n’est pas indiqué que l’Etat vienne faire des latrines pour quelqu’un qui a construit sa cour. Il faut que les latrines soient dans les plans de construction. Normalement, l’Etat et les collectivités ne doivent intervenir que pour les latrines publiques. Du reste, on a travaillé déjà à mettre en place 29 167 latrines familiales homologuées et plus de 6 000 puisards domestiques en 2023. On a des programmes comme le Programme d’approvisionnement en eau et assainissement (PAEA), l’ONEA et la direction générale en charge de l’assainissement qui travaillent pour appuyer la population à la disponibilité des latrines, surtout en milieu rural. On a essayé de réglementer le secteur en 2023 avec un décret sur l’assainissement autonome des eaux usées et excrétas. Cela veut dire, vous ne devez pas jeter votre eau usée devant votre cour ou dans la rue. On doit vous amender parce que les eaux usées doivent aller dans un système de collecte à domicile dans des puisards. Nous sommes donc en train de mettre en œuvre cette loi. Mais la loi doit travailler en amont avec ceux qui font les constructions pour que, par exemple, pour que dans chaque cité, il y ait « une villa, un système d’assainissement ».
Il y a aussi l’offensive zéro décharge qui consiste à éliminer les décharges non contrôlées dans les villes de Bobo-Dioulasso et Ouagadougou pour baliser ces sites et travailler à ce qu’ils ne soient pas reconstitués. On doit donc mettre en place un système de veille permanente pour que ces décharges ne se reconstituent pas. Déjà, le chef de l’Etat, a aussi lancé l’Initiative présentielle pour le développement communautaire qui a des composantes liées à cela. Nous menons actuellement des actions en synergie avec l’Initiative présidentielle, le ministère de la Santé, le ministère de l’Administration territoriale et les collectivités. On est en train de faire une réorganisation institutionnelle pour qu’en 2025 ce soit des situations que l’on puisse bien gérer.
S : Le chef de l’Etat a lancé l’Offensive agropastorale 2023-2025. Quel est l’Etat de mise en œuvre des activités concernant la mobilisation des ressources en eau ?
R.B. : Pour l’Offensive, plusieurs acteurs doivent intervenir. L’un des acteurs clé, c’est le département en charge de l’eau que nous conduisons. A ce niveau, nous mettons un point d’honneur pour que, pour les activités agricole, halieutique et pastorale, l’eau ne soit pas un handicap. Déjà, cette année, on note l’achèvement du barrage de Dawélgué d’une capacité de 829 000 m3 dans la région du Centre-Sud qui contribue à l’amélioration de notre capacité de stockage en eau de surface ainsi que la poursuite des travaux de réhabilitation des barrages de Lelexé et Zoungou dans la région du Plateau central et celui de Boussouma dans le Centre-Nord dont les taux de réalisation sont assez satisfaisants à ce jour. Le barrage de Samandeni bénéficiera d’aménagements de périmètres irrigués.
En termes de perspectives, un certain nombre de projets structurants sont en démarrage ou en cours de maturité. Il s’agit du Projet sécurité de l’eau (PSE) qui permettra de réhabiliter une quarantaine de barrages, du Programme de développement intégré de la vallée de Ouessa, du Programme de développement intégré de la vallée de la Bougouriba et du Projet de réalisation et de réhabilitation de barrages et d’aménagement de périmètres irrigués.
A terme, cela contribuera à l’atteinte des objectifs de l’Offensive avec le développement des activités de production agricole et halieutique autour des ouvrages construits ou réhabilités.
Mais il faut noter que les questions de mobilisation des eaux de surface, ce sont de grands projets. Et les études sont un préalable. Si vous n’avez pas d’études, même si vous voulez l’eau, on ne peut pas vous en donner. Nous travaillons également à avoir beaucoup d’études dans plusieurs régions pour ensuite intervenir par priorité.
Aussi, il y a eu la création de l’Office national des barrages et des aménagements hydrauliques (ONBAH), qui va permettre d’accélérer la réalisation des infrastructures de mobilisation des ressources en eau.
S : Quelle assurance peut-on avoir que cet office va pouvoir relever les défis, en ce qui concerne les aménagements hydrauliques ? Par exemple, le barrage de Gogo dans le Centre-Sud est pratiquement transformé en champ aujourd’hui après que sa digue ait cédé.
R.B. : Il faut faire confiance aux structures et aux hommes qui les animent. Tout ce que l’ONBAH va faire se fera conformément aux normes et à la réglementation internationale en la matière. Et la question des barrages, c’est sensible. Nous n’allons pas construire des digues pour les construire, ce sera conforme à la réglementation, pour que ce soit des ouvrages sécurisés pour la production et d’autres activités de développement. L’ONBAH va construire les barrages comme les entreprises, et même mieux, parce que c’est une société d’Etat.
S : Qu’en est-il exactement de l’avancement des travaux du barrage de Niou ?
R.B. : Nous avons visité le barrage en saison hors hivernage. Ils avaient fini le lit pour le plan d’eau avec les digues. Ils étaient en train de préparer les périmètres maraîchers. Ils avaient fini le bassin pour la pisciculture. Certes que des difficultés subsistent sur ce chantier, mais nous allons faire un suivi rapproché des travaux pour que des infrastructures aux normes puissent être livrées à la fin des travaux aux populations.
S : Une bonne partie des retenus d’eau connaissent un problème d’ensablement dû aux activités humaines. A l’échelle nationale, quelles sont les dispositions prises pour y faire face ?
R.B. : L’ensablement est un phénomène naturel. Lorsqu’il y a de l’eau, il y a le ruissellement. Les sédiments sont charriés d’un point haut à un point bas, qui se trouve être les plans d’eau. Le phénomène s’est amplifié par les actions anthropiques. Pour y faire face, il faut respecter les bandes de servitude, une distance minimale à l’intérieur de laquelle toute activité est interdite. Il faut faire du reboisement pour fixer le sol et les sédiments seront bloqués, lorsqu’il y’a ruissellement. Pour le barrage de Ziga, nous avons travaillé avec le ministère de la Sécurité pour que la population quitte la bande de servitude. Elles cultivent hors de la bande de servitude qui est de 100 mètres.
Récemment en Conseil des ministres, le ministre en charge de l’habitat a fait passer un décret qui fixe, à Ouagadougou, les limites pour les grands canaux de part et d’autre. Le canal du Mogho Naaba vers le pont Kadiogo est bien propre. Si vous laissez tomber une pièce d’argent, vous voyez la pièce. Pourquoi dans le même canal, à la cité An 3, derrière la maternité Pogbi, la même pièce d’argent est bouffée dans la boue. Nous travaillons avec la mairie de Ouagadougou pour y mettre fin. Nous sommes en train de signer une convention avec la mairie pour l’appuyer financièrement, à engager des actions à partir du mois d’octobre 2024, pour mettre un système de veille. C’est un travail de dualité, mais on va y arriver. Déjà pour les barrages 1, 2 et 3, nous avons fait le tour. Les gens sont dans le lit. Nous allons attendre la fin de la saison des pluies avant d’engager des concertations.
Avec la direction générale des infrastructures hydrauliques, nous travaillons à avoir un système qui va permettre d’anticiper sur l’envasement et d’aller curer et draguer, là où c’est possible. Des partenaires sont venus nous présenter des technologies, mais nous nous sommes rendus rendu compte que c’est assez cher. Nous avons fait un inventaire. Suivant l’inventaire, en 2023, les bandes de servitude de 97 retenues d’eau, dont 90 barrages sont matérialisés. Nous travaillons à empêcher qu’ils soient occupés. Nous allons continuer avec le PAEA qui a effectué des études d’ensablement de 75 barrages pour travailler dans ce sens.
S : Cela ne pose-t-il pas un problème d’efficacité des polices de l’eau ?
R.B. : La police de l’eau travaille beaucoup. Nous allons continuer à les renforcer. Au-delà de la police de l’eau, il y a les Comités d’usagers de l’eau (CUE), les Comités locaux de l’eau (CLE). Nous allons tous les renforcer pour améliorer leur efficacité sur le terrain. Il y a d’autres polices qui vont s’associer. Il y a la police forestière, la police de l’environnement, la Police nationale et la gendarmerie qui appuient pour faire des actions de terrains. Mais les gens sont réticents. Pour le barrage de Ziga, des populations estiment qu’elles n’ont pas été dédommagées. Pourtant lorsqu’on dédommageait, certains n’étaient pas nés. Mais, nous travaillons pour que là où les bandes de servitude sont définies, qu’elles soient respectées.
S : Le Burkina, le Mali et le Niger ont créé récemment l’AES. Quelle est la place des questions environnementales dans cet espace ?
R.B. : J’ai eu la chance de faire une mission au Mali en 2023, sur la sécurité climatique. Nous avons échangé pour élaborer un plan de sécurité climatique. Avec les trois ministres en charge de l’environnement de l’AES, nous étions à Niamey, le 2 août 2024, pour participer à la première édition de la Journée nationale de l’arbre, pour partager nos expériences. Nous sommes en bonne synergie. Pour les réunions internationales comme la COP, nous travaillons à avoir des pavillons contigus. Si ce n’est pas le cas, nous auront des événements comme les Journées du Burkina, du Mali et du Niger auxquels les trois vont participer ensemble. Pour les déclarations officielles, nous travaillons pour que ces questions ressortent, parce qu’en juillet dernier, au 1er sommet des chefs d’Etat de l’AES à Niamey, lorsqu’on a adopté les textes, dans les priorités, la question d’environnement et de l’eau ont été citées. Il nous appartient de transformer cela en actions terrain.
Aussi, l’AES regorge d’une grosse réserve d’eau souterraine et même de surface, de ressources minérales, forestières et fauniques partagées dont une politique commune de gestion permettra la mutualisation des ressources et des compétences pour renforcer la résilience des populations de cet espace. Par conséquent, les questions environnementales y occupent une place très importante car l’indépendance économique est fondée dans une large mesure sur l’exploitation optimale des ressources naturelles d’autant plus que les revenus des populations de l’espace proviennent majoritairement de ces ressources.
A titre d’exemple et dans le domaine des aires protégées, le Niger et le Burkina Faso partagent un important réseau d’aires protégées, le WAP (complexe parc W, parc d’Arly et Parc de la Pendjari) qui constitue avec le Bénin le plus grand continuum d’écosystèmes terrestres de la ceinture des savanes ouest-africaines et le territoire le plus important en Afrique de l’Ouest. Il constitue le refuge naturel le plus viable pour la grande faune menacée du Bénin, du Burkina Faso et du Niger (éléphants, lions, léopards, guépards, etc.).
Ce complexe écologique, classé Réserve de biosphère transfrontalière, est connu internationalement pour sa grande importance en termes de biodiversité. La république du Niger abrite environ 834 801 hectares de ce complexe et le Burkina Faso environ 1 076 869 hectares.
Les concertations seront renforcées afin de prendre en charge ces questions de ressources forestières et fauniques dans notre espace.
Nous allons travailler à matérialiser des actions concrètes avec les différents départements. Au Burkina, nous sommes en train de faire un mémo qu’on va partager afin que les trois ministres puissent se retrouver pour travailler sur des actions concertées.
Sur la question du trafic du bois d’œuvre par exemple à Koloko, à la frontière avec le Mali, quand on va harmoniser nos actions, lorsque vous faites le trafic du bois à la frontière avec le Mali, on va mettre un dispositif des deux côtés de la frontière pour vous appréhender.
Entretien réalisé par
La Rédaction
Légendes (Ph : Edith BAKALA)
- Le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Baro : « on a fait une étude entre l’an 2000 et l’an 2022 et s’est rendu compte que les superficies forestières ont régressé de plus de 9,6 millions d’hectares, à 7 millions d’hectares ».
- Le ministre Baro a échangé durant plus de 1h30 avec les journalistes de Sidwaya.
- Roger Baro : « nous travaillons à avoir des plans d’aménagement forestier pour toutes les forêts ».
- Le chef du département en charge de l’environnement : « récemment, on était sur le terrain, au compte du gouvernement, pour sensibiliser la population et on a passé le message suivant : oui à la lutte contre le terrorisme, non à la destruction de la forêt ».
- Pour le ministre chargé de l’environnement, l’ambition c’est d’amener les artisans miniers vers les petites mines semi-mécanisées et l’extraction des forêts classées des cadastres miniers pour faire un bond qualitatif dans la protection des forêts.
- Roger Baro : « il y a des investissements en cours qui vont permettre de clôturer la forêt classée de Kua et d’élaborer un plan d’aménagement ».
- L’Invité de la rédaction a salué le professionnalisme de Sidwaya dans le traitement de l’information.
- Le ministre Baro a visité quelques services des Editions Sidwaya, dont l’imprimerie.